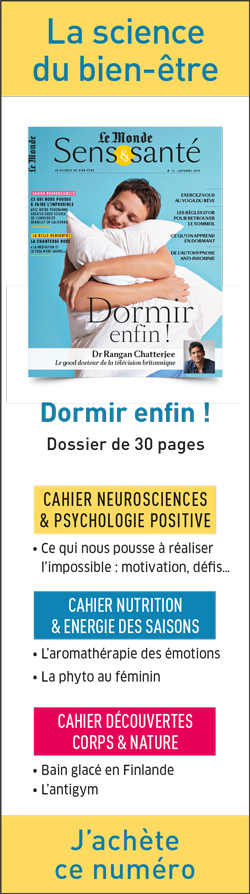Végane par conviction, séduite par la méditation, Sylvie Guillem agit au quotidien comme elle a dansé sur les plus grandes scènes du monde. Avec instinct et passion. Parcours d’une étoile déterminée.
Un corps de danseuse souple et fin, une volonté sans faille, un esprit indépendant : c’est forte de ces atouts que Sylvie Guillem s’est forgé un parcours professionnel qui lui ressemblait. Entrée au corps de ballet à 16 ans, nommée étoile à 19 par Rudolf Noureev, elle a su quitter l’Opéra pour un statut de « permanent guest star » au Royal Ballet de Londres, lui permettant de danser à travers le monde avec des partenaires et des répertoires choisis. À 53 ans, retirée du spectacle depuis trois ans, elle s’est engagée dans un combat écologique pour la planète. Elle dansera le 30 juin aux rencontres Science Art Méditation, à Strasbourg.
Du corps à l’esprit, de la scène au monde, cette femme sensible et affirmée revient pour nous sur son parcours.
Sens & santé : La danse n’a pas été un choix dans votre carrière mais le résultat d’un hasard. Quelle est votre histoire ?
Sylvie Guillem. J’ai hérité d’un corps doté d’une grande souplesse et de proportions correspondant à l’esthétisme de la danse. J’avais de longues jambes fines, de la force dans les chevilles et des pieds tordus. Ils paraissaient anormaux. Un médecin m’a demandé un jour si j’avais eu un accident. Mais cette petite bosse au-dessus du pied, plus communément appelée le cou-de-pied, est un critère esthétique essentiel pour les danseuses classiques. J’avais 11 ans et Claude Bessy, grande directrice de l’école de danse de l’Opéra de Paris a vite remarqué ces prédispositions physiques. Avec l’équipe de France de gymnastique, je préparais la présélection des jeux Olympiques de Moscou à l’Institut national du sport du bois de Vincennes. Pour parfaire cet entraînement et gagner en féminité, nous avions trois cours de danse classique par semaine. Claude Bessy m’a proposé de faire partie du spectacle de fin d’année de l’Opéra, et par la suite d’intégrer l’école de danse.
À cette époque, la jeune gymnaste que j’étais détestait la danse. La gym, c’était du plaisir, du jeu. La danse classique, c’était l’école de la discipline. Il fallait être à l’heure, porter le chignon, subir des remarques désobligeantes… Mais j’ai eu un coup de foudre pour la scène. Les répétitions, les essayages de costumes, les maquillages, l’orchestre, le lever du rideau et le public me transportaient en dehors du monde terrestre.
S.S.Votre rapport au corps a-t-il évolué au cours de votre parcours de vie et de danseuse ?
S.G. J’ai toujours été très tactile. En danse, nous nous touchons sans cesse, la taille ou les fesses, de façon technique. Dans certains portés, nous sommes assis pleinement sur les mains de notre partenaire. Assez vite, la pudeur disparaît… Adolescente et jeune adulte, j’étais contente du corps que l’on m’avait offert et de sa souplesse musculaire hors norme. Je m’amusais avec lui.
J’avais un plaisir fou. Je dansais de manière instinctive. Avant un spectacle, j’avais peur, puis j’entrais en scène et tout se passait bien. Une fois le rideau retombé, j’étais heureuse d’entendre résonner les applaudissements. Parfois même, en représentation, j’atteignais la plénitude, un état aussi incontrôlable que fragile, un autre espace temps avec l’impression de se voir danser en temps réel.
Ce n’est qu’à 36 ans que j’ai connu mon premier gros pépin. J’ai eu un accident au tendon d’Achille. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m’a bouleversée. « Vous n’avez plus 20 ans ! » m’a lâché mon médecin. En bon professeur, mon corps m’a donné ce jour-là une grande leçon : je devais en prendre soin, le respecter, l’écouter, ne pas le piétiner en pensant que tout m’était dû. Après cette période désagréable, j’ai appris à danser différemment, plus en conscience, avec une ouïe plus fine envers les signaux que mon corps m’envoyait.
Sachant que d’un seul coup, tout peut casser.
Danser, méditer et m’engager en conscience pour la planète.
S.S. La douleur fait-elle partie de la vie d’un danseur ?
S.G. Oui. Lorsque vous préparez trois ballets en même temps, votre corps souffre. Dès votre réveil, vous rencontrez des difficultés pour descendre trois marches. Un matin, avant Don Quichotte, je n’arrivais plus à bouger, ni même à me coiffer. J’avais une côte déplacée. Aux alentours de 16 heures, j’ai appelé mon ostéopathe. Il a travaillé à apaiser les tensions qui me parcouraient et m’a donné son feu vert. Le soir même, j’étais sur scène face au public. Il m’est aussi arrivé de danser avec une angine et un oeil-de-perdrix infecté. Mes chaussons étaient très serrés. Le moindre mouvement me faisait pleurer en coulisses.
S.S. Où trouve-t-on alors les ressources ?
S.G. La scène est magique. En coulisses, votre douleur vous paralyse. Elle vous paraît intense, interminable. Mais dès que vous posez un pied sur scène, porté par l’adrénaline, elle s’évapore. De plus, j’ai eu la chance d’être accompagnée par de bons professionnels de santé.
Des personnes douces et humbles en qui j’ai eu rapidement une confiance aveugle. J’allais régulièrement voir des masseurs et des ostéopathes, lesquels sentaient quand je devais m’arrêter. Plus jeune, j’ai suivi des cours en sophrologie, des visualisations utiles pour atténuer le jet-lag et les maux d’estomac causés par le stress.
À côté, j’ai appris à bidouiller : couper par endroits mon chausson trop serré, prendre des bains glacés pour récupérer après les spectacles, etc.
S.S. Et face au stress, au trac, aux doutes ?
S.G. Plus vous avez de l’expérience, plus le préspectacle devient une torture psychologique. Vous accumulez les angoisses et n’attendez qu’une chose : la libération, l’entrée en scène. Vous connaissez parfaitement vos compétences, vos limites, les risques et les attentes du public. Ces centaines de spectateurs qui ont acheté un ticket pour vous voir. Pour me rassurer, j’étais très rigoureuse dans mes entraînements.
Le travail en amont devait être fait. Le jour même, des petits rituels participaient à mon mieux-être : un bon repas, une sieste pour faire le plein d’énergie, un échauffement réalisé déjà sur scène, etc.
S.S. Comment avez-vous découvert la méditation ?
S.G. Ce jour-là, au Royal Ballet de Londres, je devais jouer ma bête noire, Le Lac des cygnes. J’étais pétrifiée par la peur. Aux toilettes, une petite fenêtre donnait sur Covent Garden, un quartier commercial et touristique fort populaire. Je l’ai ouverte pour observer l’extérieur : j’ai vu des cracheurs de feu, des vendeurs, des passants, des centaines de personnes pour qui Le Lac des cygnes n’avait aucune importance. En regardant cette foule, j’ai compris que je n’allais pas changer le cours du monde si je ratais mes fouettés. Pour la première fois, j’avais trouvé une technique efficace pour m’apaiser. J’ai souvent repensé à la fenêtre de Covent Garden.
Plus tard, lorsque j’ai arrêté la danse, j’ai entrepris un stage de cinq jours assez dense avec huit heures de méditation par jour auprès de Jean-Gérard Bloch, rhumatologue et instructeur Pleine Conscience. Apprendre à contrôler son esprit et à le transformer a tout de suite attisé ma curiosité.
Même si je suis tombée malade une semaine après. J’avais dû ramener trop de peurs et d’angoisses à la surface…
S.S. Aujourd’hui, pourquoi et quand méditez-vous ?
S.G. Curieusement, les danseurs ne respirent pas. Ils sont en apnée. De ce fait, il m’a fallu du temps pour situer la respiration de la méditation. De plus, la danse m’a appris à laisser parler mes instincts. Au contraire, en pleine conscience, vous essayez de dompter vos paniques, vos pensées, vos doutes en vue d’atteindre la paix, améliorer votre relation aux autres. Tout ce qui vous tracasse et rend votre esprit bavard, vous l’évacuez pour être plus présent.
Je médite chaque jour… mais la route est longue.
S.S. Qu’est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez mis fin à votre carrière en 2015 ?
S.G. Cette décision a été aussi difficile à prendre qu’à accepter. Je l’ai vécue comme un grand choc. Toute ma vie a été centrée autour de la danse. C’est seulement lorsque je me suis arrêtée que je me suis aperçu du travail physique que j’avais fourni. Hors de question de tout stopper. Je me suis tournée vers des disciplines sportives, certaines liées à des philosophies qui m’intéressaient comme le tir à l’arc ou d’autres comme le kick-boxing pour me défouler.
Aujourd’hui, je fais une barre par jour (avant, je détestais cela) et cela contribue à mon équilibre mental et physique. La barre est proche d’une discipline méditative. Les exercices permettent de chauffer les muscles, de dénouer les tensions mais aussi de se concentrer. En arrêtant, je n’ai pas pris un gramme. Je fais toujours 52 kg. Simplement, j’ai perdu des muscles et gagné un peu de graisse.
S.S. Vous avez adopté aussi un mode de vie végan. Quel a été le déclic ?
S.G. J’ai visionné un reportage au sujet de l’ONG Sea Shepherd, engagée dans la lutte contre la pêche illégale.
À bord des bateaux, l’intégralité de l’équipage est végan. Intriguée, j’ai lu un ouvrage écrit par le fondateur du groupe activiste, le militant écologiste canadien Paul Watson. En 2040, si l’on continue à manger du poisson, la mer sera vide, racontait-il. J’ai fermé le livre en me disant que je ne voulais pas participer à ce carnage.
Ensuite, j’ai commencé à m’intéresser au boeuf ou au poulet qui se trouvaient dans mon assiette. D’où provenaient-ils ? Moi qui me nourrissais de jambon et de fromage, bio, certes, j’ai tout arrêté. Non pour une question de santé mais parce que l’idée de la souffrance animale m’était devenue insupportable. La cinquantaine approchait. Alors que mon corps produisait moins d’énergie avec l’âge, j’ai découvert que sans viande, j’avais davantage de force et de résistance. Nos besoins en protéines sont largement satisfaits par les protéines végétales.
Pour des raisons écologiques, j’ai aussi changé ma façon de m’habiller : les chaussures en cuir, à la poubelle ! Côté santé, j’avais déjà opté pour la phytothérapie, l’acupuncture et les huiles essentielles. Je me sens aujourd’hui comme le petit grain de sable d’une grande plage. J’ai l’impression de faire partie d’un tout : le monde et son environnement. On peut devenir zen tout en continuant à détruire la planète. En prenant conscience de nos cruautés, on apprend à remettre du coeur et de la bienveillance dans notre société.
par Elisabeth Marshall avec Alice Papin
Découvrez l’intégralite de l’interview de Sylvie Guillem dans le numéro 8 de Sens et Santé
Retrouvez Sylvie Guillem Aux Rencontres SAM 2018 – Sciences, Art et Méditation du 29 juin au 1er juillet 2018 à Strasbourg.